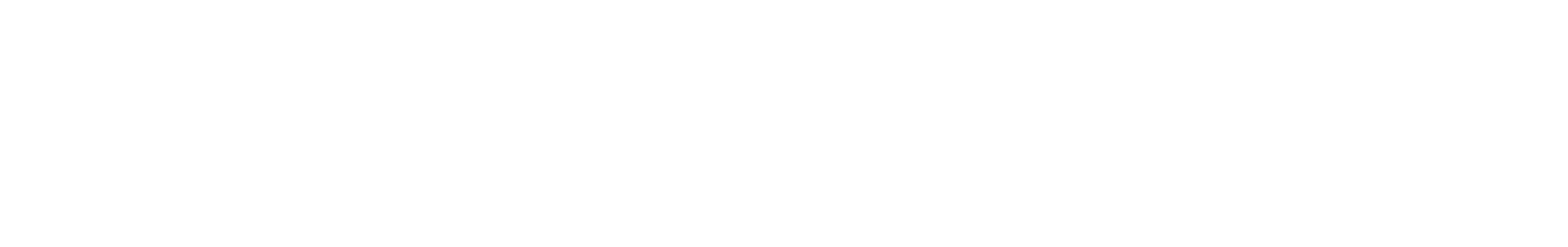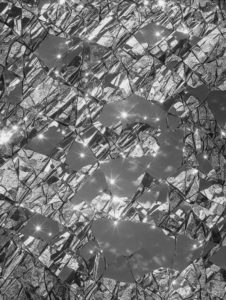Sergi López incarne dans “Sirāt“ un père à la recherche de sa fille disparue allant de Charybde en Scylla au fur et à mesure qu’il s’enfonce dans le désert avec des ravers. Un voyage au bout de l’enfer dont le comédien est revenu enthousiaste. Rencontre
Dans Sirāt, l’absence et le non visible créent des conditions favorables pour l’omniprésence de la musique et la survenue de la menace planant sur la seconde partie du film. Lorsque vous avez lu le scénario, comme vous-êtes vous figuré cette part invisible ? Vous êtes-vous préparé à “jouer” avec elle ?
Sergi López : C’est génial, cette question parce que en fait je ne me la suis pas posée : je me suis centré sur le visible. Déjà, sur le scénario, il y avait l’idée de musique au début avec la rave — et après, quand on danse dans le désert — mais sinon le reste, il n’était pas écrit qu’il y avait de la musique de fond. Il n’y avait que les actions. Le passé de mon personnage était aussi invisible.
Pour moi, au cinéma, on joue des choses concrètes. Et moi, j’ai lu le scénario comme des choses visibles— d’ailleurs, c’est un scénario très visuel, qui ne raconte que des images. On voit un mec avec son fils, on voit une rave… Tout le reste fait partie de ce que j’adore : c’est le jeu, qui est invisible, c’est quelque chose que tu vas chercher. Un regard intérieur que tu vas trouver d’une façon ou d’une autre pour essayer de croire que tu t’appelles Luis alors que je ne m’appelle pas Luis ; qu’Esteban n’est pas mon fils — d’ailleurs il ne s’appelle même pas Esteban…
Óliver [Laxe, NDR] parle souvent dans ses films d’un regard intérieur, il veut que le spectateur regarde à l’intérieur. En tout cas je crois le public est en empathie avec mon personnage dès le début. Il n’a pas de passé, il devient un personnage avec un côté symbolique : il est là, on ne sait pas d’où il vient, la vie va l’agresser, lui donner un coup de poing dans la figure et il va être obligé de regarder à l’intérieur comme il n’y a rien dans le désert. Et puis en haut : il y a ce truc vertical aussi, quelque chose de divin. Au début ça démarre de manière plus conventionnelle ou plus classique ; après, ça part dans un voyage plus métaphysique, spirituel, qui oblige les personnages à regarder à l’intérieur.

Vous incarnez Luis, mais vos partenaires de jeu conservent leur identité à l’écran. Comment cela s’est-il passé entre le comédien professionnel que vous êtes et ces non professionnels ?
Bien. Pour jouer, nous sommes tous des personnes différentes, mais nous sommes tous acteurs, parce qu’on est tous conscients qu’il y a une caméra. Ils n’avaient jamais joué avant devant la caméra, donc ils avaient cette innocence, ce malaise. Je suis un peu plus habitué mais en fait, je crois que nous les acteurs, on fait ça d’une façon évidente. On doit s’accrocher à des choses parce que rien n’est vrai : je ne m’appelle pas Luis et toute l’équipe le sait. Donc pour jouer, il faut croire, il faut avoir la foi. Et pour avoir la foi, moi, je prends tout.
J’avais plus d’expérience que les autres, mais j’essayais de passer inaperçu à côté d’eux, qu’on ne sente pas : « lui, c’est l’acteur ». J’essayais de m’inspirer d’eux. parce qu’ils ont beaucoup de “malgré eux“. Ils ne se rendent pas compte, mais ils ont une présence, un truc : comme ils ne sont pas acteurs, ils ne cherchent pas des solutions de jeu. Ils avaient peur d’être mauvais ; je leur disais que ça, on le partage tous. Moi aussi, même si j’ai fait beaucoup de films : chaque fois c’est nouveau. Ça fait partie du jeu et dans ce sens, on était assez proches.
Hors caméra, sont-ils des ravers et des routards ?
C’est des vrais travelers, de vrais fêtards. Ils font partie de ce collectif que j’ai découvert dans ce film. J’avais participé à quelques raves dans ma vie, mais pas beaucoup. Même en ayant participé, j’avais gardé un regard un peu superficiel sur ce collectif. On a une impression des gens qui dansent, qui se droguent, qui ne font rien : des immatures. Et en fait, j’étais très étonné de connaître ce collectif et de me rendre compte qu’ils étaient beaucoup plus matures que la moyenne (sourire).
Parce qu’ils se sont vraiment posé des questions ; ils ne sont pas juste là : ils sont dans les marges parce qu’ils ont déserté. Ils croient que le système dans lequel que nous vivions — secrètement, je crois qu’on le partage tous un petit peu — est en train de partir un peu en couille et ne veulent pas y participer. C’est quelque chose qu’ils ont fait en toute conscience car ils ont beaucoup de conscience collective, sociale, féministe, écologiste. Ils ont tous des des camionnettes, ils connaissent tous la mécanique, ils savent tous trouver de l’eau, ils connaissent beaucoup les herbes médicinales… Ils ont cette idée de soigner collectivement, de ne pas agresser, d’essayer de vivre dans une certaine sécurité collective..
S’ils font une rave avec 2000 personnes, quand ils démontent tout, il n’y a pas un petit papier par terre. Et puis, c’est une anecdote, mais ils font une fête de 1500 personnes : pas une seule bagarre. Alors que chez moi, il y a une fête de 15 personnes, il y aura deux mecs qui se cassent la gueule (sourire)
Pourtant le scénario n’est pas tendre avec eux, surtout sur la fin…

Le scénario est semé de surprises et de retournements brutaux. Comment les avez-vous ressentis ?
J’ai adoré quand je l’ai lu. À un moment donné, quand il se passe cette claque énorme, extrême, de douleur, je me suis dit : « Oh, c’est pas vrai, c’est quoi ? », je trouvais ça nul. Ça m’énervait mais j’ai continué à lire en me demandant : « Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi ils s’en vont ? Pourquoi le père ne reste pas ? Il s’en va où ? Qu’est-ce qui se passe ? » Et j’ai vu qu’en fait ça partait vers quelque chose d’autre, une espèce de méditation sur la mort, comme disait Olivier et qu’après ils prenaient un truc, ils dansaient…
Moi aussi j’ai été surpris par étapes. Je ne suis pas très intellectuel, je suis surtout intuitif et j’ai beaucoup aimé : c’est un film que je ne sais pas à quoi comparer, ni dire à quel quel genre il appartient. On croit à aller dans un endroit, et on est tout le temps secoué. Je me suis dit : « Putain, qui a écrit ça ? » C’est bizarre, c’est étrange, c’est douloureux à la fois et je crois qu’à la fin, il y a de l’espoir quand on se retrouve avec d’autres survivants dans un train…
Jouer, c’est ça en fait. Quand j’étais jeune je pensais que les acteurs apprenaient à jouer et qu’après, ils pouvaient tout jouer. C’est pas vrai : ’à chaque fois que tu joues, tu recommences. Tu ne peux pas jouer un truc en te disant : « j’ai déjà joué un truc un peu comme ça dans un autre film. » C’est toujours une tentative ce qu’on fait. On a donc fait cette tentative, on savait qu’il n’y avait pas le choix. On l’a fait assez vite, la deuxième semaine — moi ça m’arrangeait, parce que ça me stressait beaucoup
Après, j’ai beaucoup pleuré dans ce film, plus que jamais… Mais j’ai pleuré dans le plaisir de le faire, dans la joie. Pour jouer ça, je n’ai pas besoin de penser à ma douleur à moi. J’ai déjà joué à un mec qui a perdu sa mère — je n’ai pas encore perdu la mienne ; penser que je l’ai perdue ne m’aide pas beaucoup ; ça me sort du jeu. Ça m’aide beaucoup plus de penser à un mec qui s’appelle Luis, qui voit ça et qui s’évanouit. D’imaginer que c’est quelqu’un d’autre. Et puis quand tu joues au milieu du désert, c’est génial : il fait vraiment chaud, tu as vraiment du sable dans la gueule, tu as soif, la caméra est loin… c’est plus facile de rentrer en transe (sourire).
Êtes-vous restés longtemps dans le désert ?
On a fait trois semaines en Espagne — la première partie de la rave, avec les falaises — et après quatre semaines au Maroc, intégralement dans des déserts de montagnes, de sable blanc très dur, de sable mou, de petits cailloux un peu volcaniques… Des décors vraiment puissants qui te nourrissent.
La musique était-elle présente sur le plateau ?
Il n’y en avait pas ! (rires) Il y en avait dans la scène du début avec la rave : le deal, c’est qu’ils avaient organisé une vraie rave qui durait trois jours — tout ceux qui venait savait qu’il y avait un film, donc ils étaient d’accord pour être filmés, mais l’équipe de tournage n’avait pas le droit d’arrêter la rave.
Ça a duré trois jours non-stop, comme une espèce de mélopée ancestrale. Et après, quand on a fait la scène dans le désert où ils sortent les enceintes et qu’on danse — là on avait de la musique. Mais le reste non : on savait qu’il allait mettre la musique, mais pas exactement où. Pourtant je trouve que la musique transporte dans ce film. Quand j’ai vu le film fini à Cannes, avec la musique et le siège qui tremble, j’ai trouvé que ça portait fortement : ça entre, c’est un peu hypnotique, ça t’aide, il y a un côté transe.
Óliver Laxe vous a-t-il donné beaucoup d’indications ou vous a-t-il laissé faire ?
Pas à moi, parce que je lui dis : « Laisse-moi tranquille » (sourire). Il donne des indications mais tout ce qui est dans le film, tous les dialogues, c’est écrit. En fait, je lui ai pris beaucoup la tête longtemps pour une phrase. Óliver voulait que la mort soit définitive, et que le voyage soit vers l’avant et qu’on ne puisse pas retourner en arrière.
Alors, j’ai rajouté la phrase : « on ne peut pas la laisser ici ». Et dans une autre scène : « je ne peux pas partir, il faut qu’on revienne » ou « moi, de toutes façons, je vais revenir » Des phrases comme ça… Óliver s’en foutait. Pour lui, c’était un voyage : ce qui l’intéressait c’est la mort comme une claque, un virage dans la vie, et puis ce qui vient après. Il voulait présenter le film comme une méditation sur la mort et rentrer directement sur le deuil, comment on fait pour avancer avec ça. Drôle de sujet (sourire)…
Spoiler
C’est très rare aujourd’hui dans un film, de tuer un petit garçon…
Il n’est pas fréquent non plus d’avoir personnages amputés comme protagonistes…
C’est vrai. Óliver dit qu’on a tous des blessures. On avance avec nos blessures. Et c’est un collectif qui montre ses blessures : on en voit un à qui il manque une jambe, et moi il me manque une fille. Chacun a des trous ou des pertes, on est tous handicapés d’une façon à l’autre. C’’est pareil avec toutes les différences, les incapacités psychiques : si tu n’es pas habitué, quand tu vois pour la première fois quelqu’un qui n’a pas de jambe — ou qui a un syndrome de Down, ou qui est autiste, ou qui a un trouble mental… — et que tu ne le connais pas, ça dure 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, tu vois qu’il est comme toi.
On appréhende, mais lui, il s’en fout : il vit comme ça, il n’a pas de jambe. Donc, au bout d’un moment, il te raconte comment il a perdu la jambe, et puis voilà, c’est fini. C’est un être humain…

Sirāt de Óliver Laxe (Esp.-Fr., 1h55) avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy… En salle le 10 septembre 2025.