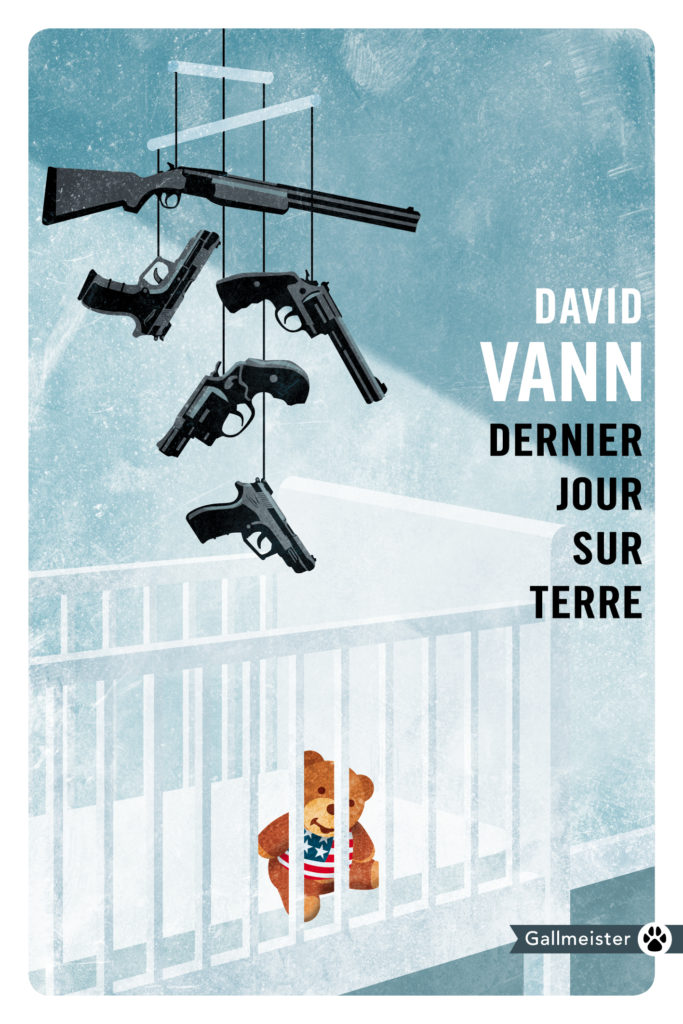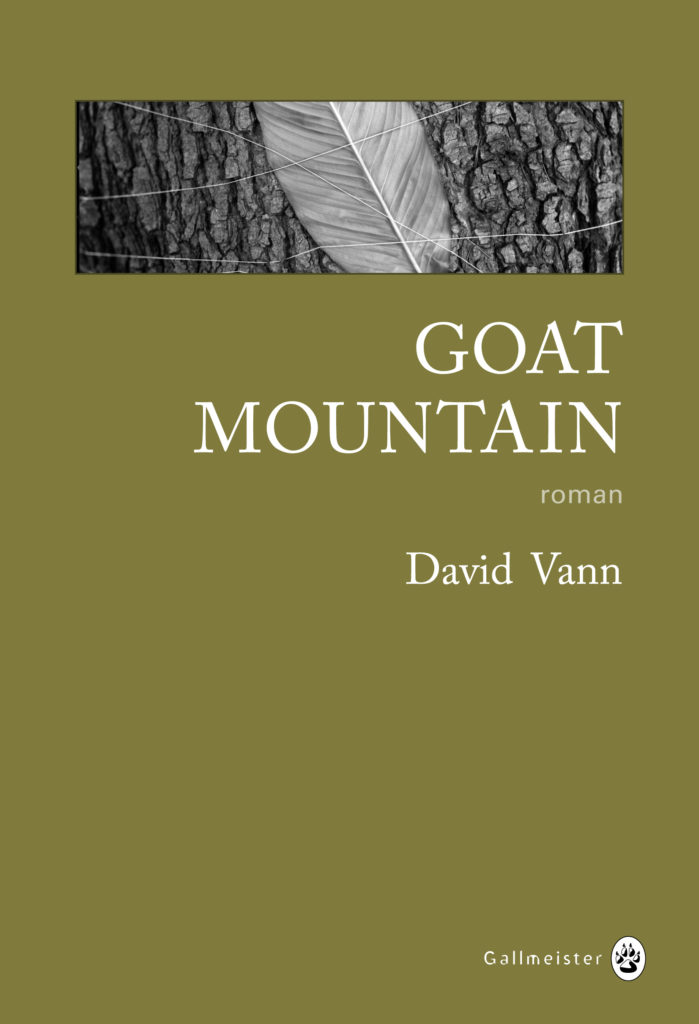…mais la culture permet de dépasser nos instincts.
David Vann
<<Retour en 2014<< Avec l’acuité qu’on lui connaît depuis le choc Sukkwan Island (Prix Médicis étranger 2010), David Vann nous offre par la fiction et l’essai une double autant que glaçante analyse de son pays, les États-Unis, vivant le cran de sûreté bloqué. Tête-à-tête pacifique avec un géant des lettres pacifié…
Nous nous voyons à une heure matinale qui, d’habitude pour vous, est réservée à l’écriture ou à la relecture. Vous arrive-t-il souvent d’opérer des ruptures dans votre discipline ?
David Vann : Oh, ça m’arrive chaque année. Durant les sept dernières années, j’ai écrit sept livres : je passe six mois très intenses à écrire, et puis les six mois suivants, je tourne autour de mon texte, j’essaie de le comprendre, j’effectue tout le travail éditorial… J’en profite aussi pour collaborer à des magazines, pour écrire des scénarios, mais aussi pour faire de la traduction — cela fait trois ans que je traduit du latin en anglais. Quoi qu’il arrive, je consacre tous les matins deux heures à des activités en lien avec l’écriture. Cette année, j’ai terminé un peu plus tôt que d’habitude l’écriture de mon livre, et je suis donc en ce moment dans ma phase de révision. Mais je ne le vis pas comme une rupture, parce que j’aime bien me préparer psychologiquement à me plonger dans de nouvelles pages.
En revanche, ce qui est particulier cette année, c’est que je risque sans doute d’écrire constamment, car j’ai déjà rédigé les quarante première pages d’un nouveau livre. Et je vais très bientôt le reprendre. Mais ce deuxième roman, il est vraiment pour rigoler ; il est tellement fou que je doute qu’on puisse le publier un jour : ça raconte l’histoire de Jésus, allongé sur la plage au Mexique en train de boire des tequilas et de traduire Les Métamorphoses d’Ovide, et il tient beaucoup de discussions sur la tequila et l’archéologie… (rires)
Cette habitude d’écrire puis de laisser du temps avant de reprendre votre texte, correspond-elle à une nécessité de vous mettre à distance d’histoires qui sont souvent proches de votre vécu ?
Oui, absolument. Et c’est compliqué à faire, mais j’ai un point de vue vraiment neuf une fois que je l’ai fait. Lorsque l’écriture est achevée, je me fais une sorte de résumé avec les étapes fortes, et du coup, je me retrouve avec cinq pages qui me permettent d’analyser la structure, la construction du roman. Je peux alors corriger les passages dont le rythme me semble trop faible ou qui me paraissent un peu ennuyeux, améliorer quelques phrases maladroites…
Goat Mountain doit être un de mes meilleurs livres, parce que je suis quasiment resté sur le premier jet, je n’ai presque rien changé.
Ce résumé étape par étape, je l’ai toujours employé avec des livres, mais aussi avec des scénarios, parce qu’il permet de mieux voir et analyser la structure dramatique de l’œuvre.
Vous êtes dans une année de double écriture, mais c’est aussi pour vos lecteurs français une année à double parution, avec deux titres édités simultanément. Les considérez-vous comme deux ouvrages traitant en miroir de la question des armes aux États-Unis ?
En fait, Dernier jour sur terre a été a été une des sources principales du roman Goat Mountain, lequel pose la question : comment peut-on tuer sans éprouver d’émotion face au meurtre ? Si la plupart des tueurs de masse décrits dans Dernier jour sur terre ont fait l’armée, et ont donc une expérience militaire, les plus jeunes viennent de la culture de la chasse — c’est que je décris en fait dans Goat Mountain.
C’est aussi mon histoire à moi, j’ai eu des expériences traumatisantes, notamment le fait d’exécuter un cerf en l’achevant dans le dos. Sur le ranch où ma famille chassait (qui s’appelle réellement Goat Mountain), mon père regardait régulièrement par le viseur de son fusil les braconniers qui chassaient de manière illégale ; j’aurais très bien pu comme le héros appuyer sur la gâchette et tuer un gars. L’événement inaugural de Goat Mountain appartient donc au domaine du possible : c’est ce qui aurait pu arriver.
Et dans le récit Dernier jour sur terre, j’inclus ma propre histoire, ma propre interrogation sur les armes à feu, mes mémoires de mon enfance où j’avais le droit de les utiliser. Le roman complexifie la chose : les questions deviennent plus générales sur ce que et qui nous sommes, ce que c’est que l’Homme, et l’implication de la culture, de la religion dans le fonctionnement de cette tragédie.
“Ce qui aurait pu être possible”, c’était déjà la matrice de Sukkwan Island. Dans Dernier jour sur terre, vous montrez un fascinant parallélisme entre Steve Kazmierczak, le tueur, et vous. La différence notable, c’est que vous n’avez jamais glissé, vous avez su vous arrêter…
Je crois que c’est le contexte culturel qui m’a sauvé. J’ai eu une enfance beaucoup plus positive et heureuse que Steve, notamment une mère qui était plus intelligente, et meilleure, d’une certaine manière. Mon entourage, à l’adolescence, était aussi beaucoup plus sain : Steve s’est retrouvé dans un contexte très difficile, pauvre ; quelques uns de ses amis sont devenus dealers très tôt… C’est surtout l’enfance et le contexte culturel qui font que l’on bascule ou pas. Lorsque les parents de Steve se sont adressés à l’école, celle-ci n’a rien fait pour l’aider. Alors que moi j’ai eu j’ai eu accès à des cours de théâtre, qui ont été extrêmement salutaires, et qui m’ont permis de me tirer de cette double vie de mensonges.
Ce qu’il faut souligner également, c’est que Steve a failli devenir “normal”, et c’est l’université qui l’a aidé, lorsqu’il est devenu tuteur auprès des étudiants — il était tout à fait en empathie avec eux. Pendant cinq ans, il a tenté de se remodeler, de se réinventer autrement. Il n’a pas réussi, mais c’est l’université qui aurait pu l’aider à se reconstruire. L’université et les arts sont deux éléments capables de palier tous les dommages causés par les armes et cette culture militaire qui influencent tellement les jeunes.
Dernier jour sur terre expose frontalement plusieurs problèmes majeurs de la société étasunienne : l’insoluble question de la libre vente d’armes à feu, le suivi médical déplorable des anciens militaires, le faible accompagnement des personnes en difficulté psychologique…
Le traitement médical des problèmes psychiques et mentaux est totalement insuffisant : ce que l’on fait habituellement, c’est bourrer les gens avec des cocktails de drogues qui non seulement ne fonctionnement absolument pas ensemble, mais créent des interactions bizarres. Un article dans le New York Times faisait état de 1,2 millions de vétérans demandant une psychologique mais n’en recevant aucune. Ce qui fait qu’il y a un paradoxe énorme : d’un côté on dit que l’armée c’est quelque chose de positif, qu’il faut soutenir les troupes, on proclame qu’elle est formidable parce qu’elle apporte du bien et qu’elle protège, on interdit de la critiquer et de l’autre, les soldats démobilisés n’ont rien, pas d’argent. On les a séparés de leur famille, donc ils se se retrouvent complètement seuls, on les a entraînés à tuer justement sans éprouver aucune émotion, cela donne des gens complètement détruits…
On pense à tous les films post-Vietnam…
Le problème, c’est qu’il y a moins de retours de ce genre aujourd’hui car la culture est devenue plus conservatrice qu’après le Vietnam. Alors, malgré tout notre background culturel, on refait les mêmes erreurs — en l’occurrence comme avec l’Irak. J’ai eu affaire à beaucoup de vétérans dans les ateliers d’écriture où j’enseigne en Floride. Tous ont commis, d’une certaine manière, des crimes de guerre, et chacun d’entre eux veut retourner au front pour tuer davantage. C’est comme une drogue, le fait de tuer. C’est une espèce d’addiction naturelle — mon Dieu, c’est la première fois que je dis cela ! Ce n’est pas très positif, comme conclusion…
Mais l’Homme a inventé l’écriture pour dépasser cela…
De toute manière, la culture, depuis toujours, c’est ce qui nous permet de dépasser nos instincts les plus primaires, la brutalité innée de l’être humain. Culture, littérature, université… voilà des choses positives !
Propos recueillis par Vincent Raymond, traduit de l’anglais (américain) par Ekaterina Koulechova & Vincent Raymond
Dernier jour sur terre, de David Vann, Gallmeister, 256 pages (5 heures de lecture), 10,50 euros.
Goat Mountain, de David Vann, Gallmeister, 256 pages (5 heures de lecture), 23 euros.