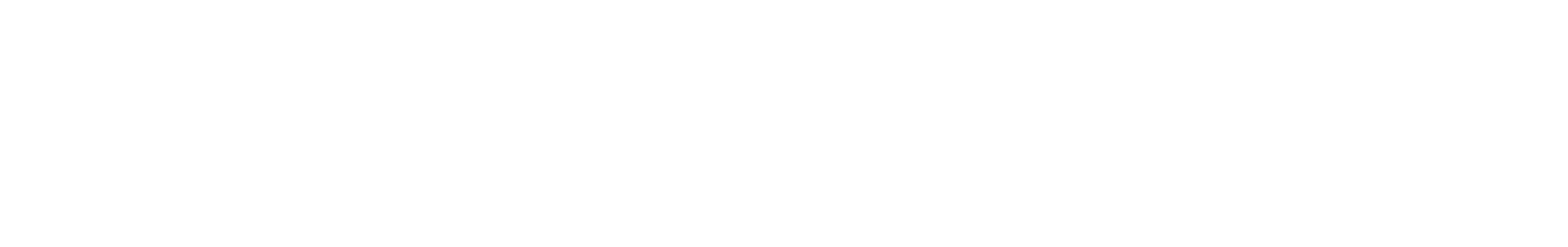Des journalistes en quête de scoops à la montagne ou dans les campagnes se croisent dans les salles cette semaine. Entre autres…
L’Accident de piano de Quentin Dupieux
Devenue riche et célèbre sur les réseaux sociaux en publiant des vidéos d’elle s’infligeant des mutilations diverses, Magalie “Magaloche” Moreau a brusquement tout arrêté pour se réfugier dans un chalet des Alpes avec son homme à tout faire, Patrick Balandras. Hélas pour elle, son incognito fait rapidement long feu : non seulement un fan local la reconnaît, mais Simone Herzog, une journaliste use de moyens de pression pour obtenir ce que personne n’a jamais eu d’elle une interview

L’Accident de piano serait-il le quatrième volet d’un tétraptyque non officiel entamé par 🔗Quentin Dupieux avec Yannick (2023), puis 🔗Daaaaaaalí ! et 🔗Le Deuxième Acte (2024)? Une série de films (dont on se gardera bien de dire qu’elle est close tant l’auteur est prolifique) ayant en commun de pousser des artistes dans leurs retranchements ; où des tiers intrusifs (journalistes, public, alter ego) les questionnent non seulement sur ce qu’ils font (leur œuvre) mais sur ce qu’ils sont (leur essence). Dans chacun des cas, l’Homo artis se trouve contraint de justifier sa production comme s’il devait répondre à une instruction judiciaire ; ses inquisiteurs peinant à admettre que son œuvre soit son langage… et réciproquement.
Un talent monstre
Certes, Dupieux s’est déjà frotté à la question de la création artistique, mais davantage pour tenter de décrypter le mystère de l’inspiration et cerner les frontières avec le songe (Reality) ; ou encore pour s’amuser avec le défi narratif du conte (Fumer fait tousser). Cette variation sur le thème de l’artiste malmené (et vaguement incompris malgré le succès) ajoutée à la volonté exprimée du réalisateur de s’alléger les contraintes promotionnelles usantes inhérentes à chaque sortie, plaide pour le message personnel, le germe autobiographique à l’embryon de chacun de ces films. En même temps, qui ne serait pas là d’entendre deux fois par an le même tombereau de questions déversé dix fois par jour durant deux semaines — soit le temps de tourner film selon les critères Dupieux ?
Cette hypothèse posée, n’en déduisons pas que le cinéaste sanctifie par principe “l’artiste” — ici, la productrice de contenus Magaloche. Sans la juger non plus, il montre comment son insensibilité à la douleur l’a conduite à déverser des tonnes de vidéos auto-mutilatrices/masochistes sur le Web dont les milliards de vues lui ont permis d’amasser une immense fortune. En effet, qui est à blâmer ici : l’exhibitionniste créant des performances limites ou bien la horde internautes voyeuristes encourageant la production de ses films ?

Comédie noire en blanc
Au reste, Magaloche est-elle à l’instar d’Orlan ou de Crazy White Sean une artiste ? Elle balance entre la citation de Cocteau (« Ce qu’on te reproche, cultive-le : c’est toi ») et les vers d’Aragon (« Ce qu’il faut de malheur pour la moindre chanson/(…)/Ce qu’il faut de sanglots pour un air de guitare ») Quant à l’émanation du public, le fan — incarné par un effrayant Karim Leklou, plus écarquillé que nature — son comportement hystérique et grégaire interroge sur ce qu’il comprend ou apprécie réellement dans la démarche créative…
S’il tient fatalement du jeu de massacre, L’Accident de piano n’épargne aucune bassesse humaine: la tyrannie des artistes-égotistes traitant leurs employés comme des laquais ; les employés à la servilité obséquieuse ou les maîtres-chanteurs au petit pied. À chacun son dû. Le plus cocasse est sans doute que ce concentré de pourriture est en quête d’un blanc virginal : l’essentiel de l’histoire se déroule sous un manteau neigeux, dans une lumière « à la Dupieux » à la luminosité poussée ; quant à Magaloche, elle ne se nourrit que de yaourt nature.

Impossible de conclure sans saluer dans ce quatuor principal Adèle Exarchopoulos dont Quentin Dupieux (après Mandibules) obtient à chaque fois une métamorphose pour ne pas dire une transfiguration. Il ne s’agit pas en effet du simple ajout d’un postiche ou de bagues dentaires, mais d’une incarnation saisissante avec son registre d’expressions, ses spécificités propres. Et plus le temps passe, plus on a l’impression que ce caméléon en a encore sous la pédale. À quand le prochain Dupieux ?
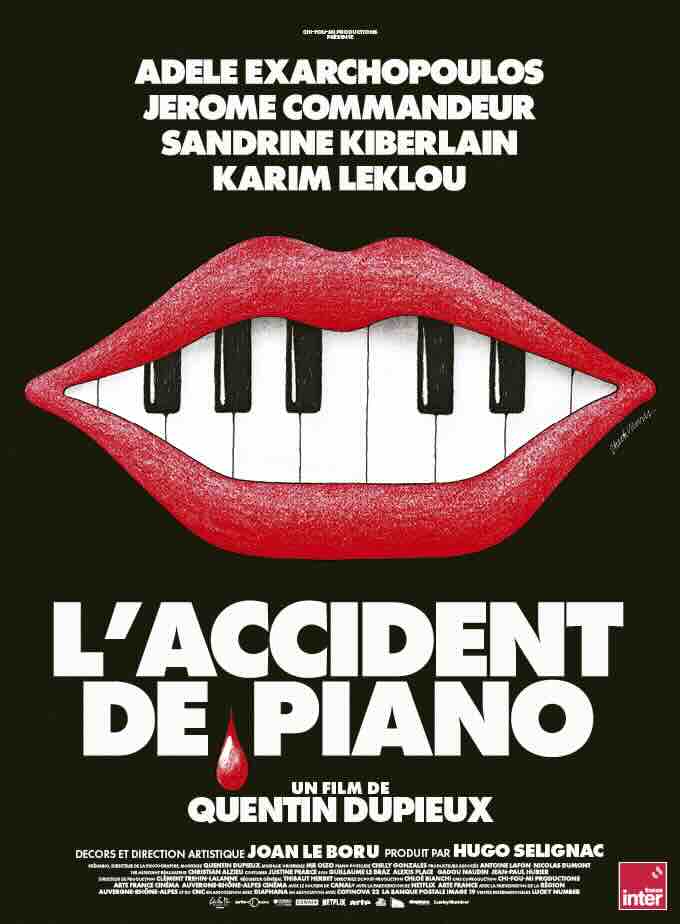
L’Accident de piano de Quentin Dupieux (Fr, 1h28) avec Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlain, Karim Leklou… En salle le 2 juillet 2025.

***
Rapaces de Peter Dourountzis
Journaliste d’investigation pour un magazine spécialisé dans le faits divers, Samuel enquête sur le meurtre sordide d’une jeune femme à l’acide. Flairant un scoop, il décide de suivre son intuition et de passer outre les injonctions de sa hiérarchie lui intimant de changer de sujet. Dans cette affaire, il est épaulé par sa stagiaire de fille, Ava, qui découvre avec lui les ficelles du métier mais aussi ses dangers…

Après Vaurien (2020), Peter Dourountzis signe un film à l’ancienne sur un sujet d’aujourd’hui. “À l’ancienne”, dans le sens où la traque de serial killers par un cavalier (presque) seul flirtant avec la légalité s’avère un motif classique. Le fait qu’il s’agisse d’un groupe mascu ciblant des femmes renvoie a contrario à une préoccupation plus contemporaine, la prise en compte des féminicides, qu’appuient la présence et le regard du personnage d’Ava, incarnation d’une nouvelle génération. Même si la rédaction n’est pas un ramassis de vieux schnocks misogynes — elle est dirigée par une patronne et on y trouve une enquêtrice de choc —, on devine la trace de réflexes et d’habitudes datant d’un autre temps. Voilà pour le portrait du “métier” où les plus habiles faits-diversiers louvoient entre bluff, informateurs et flair. Mais ils ne sont pas les rapaces du titre.
Une scène de restau impériale

Œuvre noire hantée à la fois par la radicalité de l’authenticité et la mythologie de tout un genre de cinéma (on le voit dans le soin porté aux plans tournés de nuit ; on l’entend dans le travail sur la bande son et le hors champ privilégiant la suggestion à la monstration), Rapaces se trouve néanmoins pénalisé par une inégalité de rythme. Elle se fait d’autant plus criante que certaines scènes ont manifestement bénéficié d’un traitement de faveur en termes d’écriture et de réalisation. À l’image de la séquence se déroulant dans le restaurant Le Napoléon, impeccable de suspense et de tension, qui éclipse même une (trop courte) poursuite finale aux allures de decrescendo après cet apogée.
De même regrette-t-on la soudaine volatilisation du gentil mentor interprété par Jean-Pierre Darroussin, ravalé au rang de personnage utilitaire dont le scénario se débarrasse lorsqu’il n’en a plus besoin — comme beaucoup d’autres, d’ailleurs. Ce traitement s’avère d’autant plus dommageable que sa silhouette de vieux sage faussement désabusé est fort bien dessinée, à l’instar de celle de ses compagnons de labeur au demeurant. Aussi frustrant qu’un goût d’inachevé.
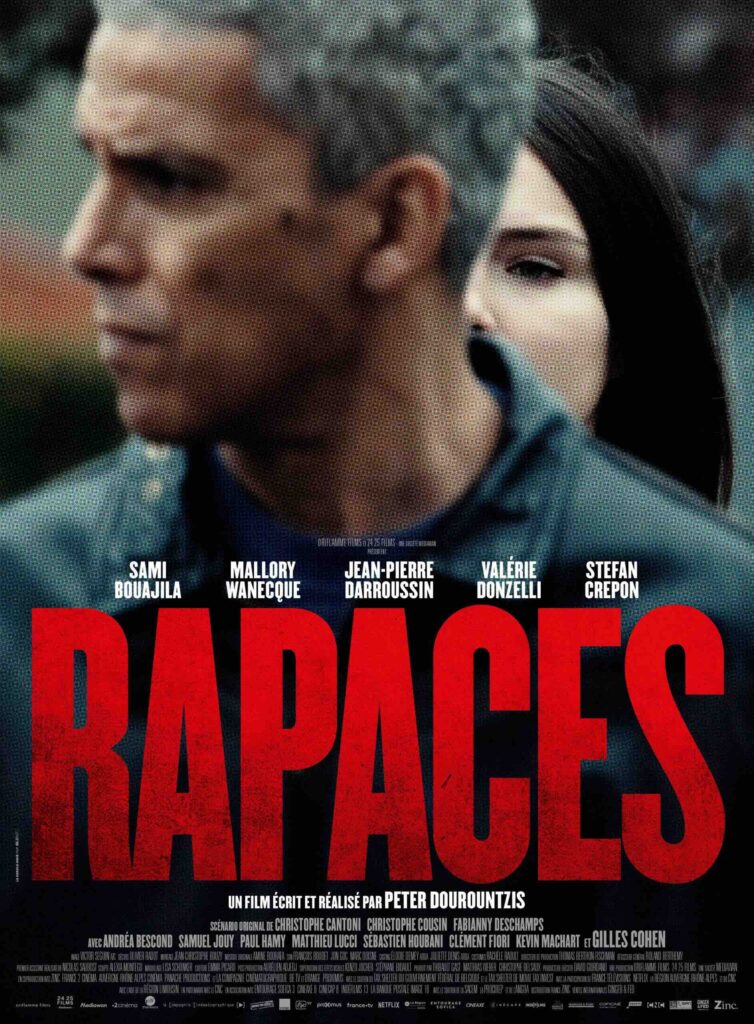
Rapaces de Peter Dourountzis (Fr., 1h43) avec Sami Bouajila, Mallory Wanecque, Jean-Pierre Darroussin, Valérie Donzelli, Stefan Crépon, Andréa Besson, Gilles Cohen, Paul Hamy, Matthieu Luci… En salle le 2 juillet 2025.